| |
arracha son sabre; le lança loin d'elle et ils commencèrent une
danse où ils se poursuivaient, s'atteignaient, s'entrelaçaient, se
fuyaient, se cachaient et se retrouvaient; puis ils allèrent se
perdre l'une dans le groupe des femmes, et l'autre dans celui des
hommes. La musique accompagnait avec la plus grande intelligence
tous les mouvements des deux acteurs de cette gracieuse pantomime,
à laquelle la clarté incertaine et vacillante des torches ajoutait
un charme indéfinissable. (1) »
A Laghouat et à In Salah, il m'a été donné d'observer une autre
danse Ouled Naïl qui est infiniment gracieuse, la danse des
mouchoirs :
« Nous prenons place sur des coussins et dès notre entrée deux
musiciens indigènes soufflent dans leurs rhaïtas et gagnent «
leur cachet en ville » de toute la force de leurs poumons. En les
regardant je songe aux vers de Hugo « ... coupe-jarrets à faces
renégates ».
« Près d'eux, en face de nous, sont assises quelques Ouled-Naïls
dans leurs vêtements de parade : longues tuniques de mousselines
blanches ou bleues, d'un bleu pâle et criard, comme aiment en
porter les paysannes de France les jours de foire et de procession.
Mais ces danseuses n'ont que ce point de commun avec les « Enfants
de Marie ». Au repos cependant leur maintien est d'une parfaite
correction et même lorsque, en dansant, elles miment les gestes les
plus précis de l'amour, leur visage demeure d'une impassibilité
absolue. Le « chef d'orchestre », pour désigner à chacune son
tour, l'appelle d'une onomatopée gutturale, quelque chose comme «
tropp ».
« Aussitôt l'une de ces demoiselles se lève, faisant bruire les
multiples bracelets de ses chevilles et de ses avant-bras, le
bandeau de sequins qui barre son front, sous une coiffure en
filigrane d'argent ou d'or. Ses pieds menus accélèrent la cadence
sur le tapis de haute laine, et ce frémissement monte le long des
jambes, s'amplifie au bassin en vagues de volupté, et vient mourir
le long des bras levés, au-dessus de la tête immobile, dans le
tremblement des doigts minces qui agitent un mouchoir de soie,
ondoyant et diapré comme une flamme.
« Le bachaga doit connaître les goûts des Européens, car les
danseuses qu'il a choisies sont minces, jeunes,
(1) Léon ROCHES. - Dix ans à travers l'Islam.
1834-1844- Paris Perrin et Cie 1904, in-18, p. 58-59.
|
|
|
|
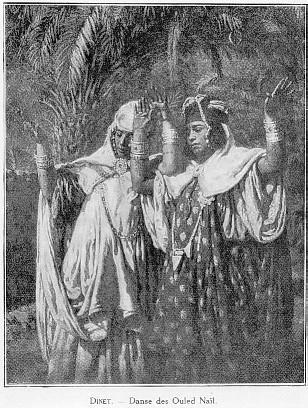
|
|