| |
|
théories des
anthropologues sont souvent assez risquées. Bénéfice
certain, car notre devoir n'est-il pas, à nous les
universitaires bourrés de lectures, d'apprendre à nous
défier des livres qui s'interposent trop souvent entre notre
oeil et la vie? « Comment ne pas noter à la fois « combien
est utile la connaissance indirecte et livresque et combien
elle est insuffisante, inexacte même dans sa précision?
Ainsi, je n'ai à proprement parler rien appris de nouveau
sur le relief |
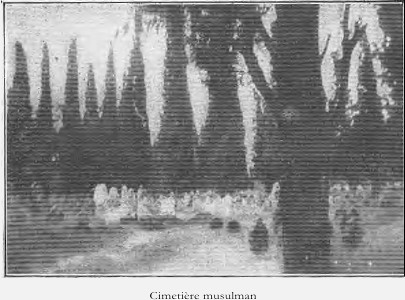 |
|
de l'Algérie
et pourtant j'en ai une idée tout autre... » M. Barbelenet,
professeur au Lycée Lakanal, pense que le séjour qu'il a
fait en Algérie ne sera pas inutile à ses élèves de lettres
; je sais bien que mes élèves de troisième B ne
m'auraient pas témoigné une émotion aussi vive au cours
d'une explication de la mort de Sylvestre de Pierre Loti, si
à Touggourt, tandis que je méditais sur le pieux anonymat
des tombes musulmanes, je n'avais pas senti se draper sur
mes épaules le lourd manteau d'argent incandescent. »
|
|
|
|
|
D'autres, comme M. Boussinesq, professeur de première
au collège de Brive, considèrent que « pour un professeur de lettres
le profit le plus clair est celui (qu'il) a retiré de la
contemplation des « Villes d'Or ». M. Eude, professeur de cinquième
au Lycée de Chambéry, nous revient avec une âme de militant :
aussi je ne me lasserai pas de vanter aux jeunes gens vigoureux et
entreprenants le charme de cette France d'outre-mer, si près de la
métropole, qui offrira un vaste champ à leur activité intelligente,
dans tous les domaines, en particulier dans l'exploitation minière
encore à ses débuts », tandis que M. Denis, professeur d'espagnol au
Lycée d'Orléans, se contente de nous donner des pages très
ingénieuses sur ce qu'il a vu pendant le mois qu'il a consacré à
parcourir le Maghreb. Nous relevons entr'autres cette jolie
explication du succès que les lignes d'autobus rencontrent chez les
indigènes : « Elles (les Compagnies de transport) exploitent
l'instinct séculaire du nomade... Famélique, loqueteux, l'indigène
passera « des journées entières au soleil, sur l'impériale, pour
satisfaire sa passion vagabonde. Une vie nouvelle est née pour lui
avec la voiture mécanique. Il en profitera donc et délaissera mulet
et chameau. Mais ci en cela il ne fait que céder à la fatalité. Il
s'installe dans l'autobus comme il s'est installé dans la vie
française ; Mektoub ! » Les professeurs d'histoire et de géographie
ont eu deux préoccupations différentes. L'une les portait vers les
études d'érudition : la générosité du Comité a été pour eux
l'occasion de recherches portant sur la géographie physique ou
humaine, sur l'archéologie de l'Afrique du Nord, l'histoire de l'art
mauresque, la sociologie ou la colonisation de l'Algérie française.
L'autre les incitait à obéir à la circulaire ministérielle qui leur
conseillait de rechercher |
|