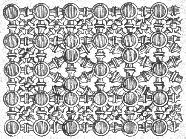| L'ART ARABE | AL. GAYET | LIVRE VI. - CHAPITRE I. | ||||||||
|
Ce n'est donc que par les contes des poètes de Haroun-er-Reschîd ou l'inventaire du trésor de Mostanser qu'il nous est possible de nous faire une idée de ce que fut le luxe des khalifes de Baghdad ou du Caire; malheureusement, les Arabes n'ont jamais su ce que c'est qu'une description rigoureuse; un détail les a frappés, ils n'ont pas vu l'ensemble. Leur témoignage peut être utile à fixer un point d'histoire ; il n'est d'aucun secours à qui cherche à dégager la philosophie de l'art. Par contre, les XIVe et XVe siècles nous ont légué de nombreuses oeuvres dispersées aujourd'hui dans les musées et les collections privées. Les plus importantes sont au musée arabe du Caire; ce sont elles que je citerai souvent ici. La description de la mosquée du sultan Hassan a déjà montré quelle splendeur était celle du sanctuaire baharite. La richesse du mobilier sacerdotal ne le cédait en rien à celle du décor. En outre du mimber et du dekke; qui peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de l'édifice, le maksourah des mosquées royales renfermait un koursi ou pupitre sur lequel était lue la sourate-el-kaf du Koran à la khotba du vendredi. Des lampadaires de bronze ciselé encadraient le mirhab, afin d'éclairer l'iman pendant la lecture du prône; des tapis précieux jonchaient le sol; des lustres de bronze et des lampes de cristal émaillé pendaient de la voûte; et dans certaines mosquées dont la disposition rappelle celle des sanctuaires primitifs était installé un kaîlagha - sorte de bassin de marbre, - qui servait aux ablutions du souverain, alors que la foule accomplissait les siennes au mahîdaah. Enfin, chacune de ces mosquées avait ses korans précieux enluminés par les plus habiles miniaturistes; les cassettes de marqueterie ferrées d'or servant à les renfermer ; les tentures de soie ou de tapisserie dont était drapé le mimber aux jours de fête; les étendards qui y étaient arborés et les armes qui y étaient suspendues. |
|
|
||||||||